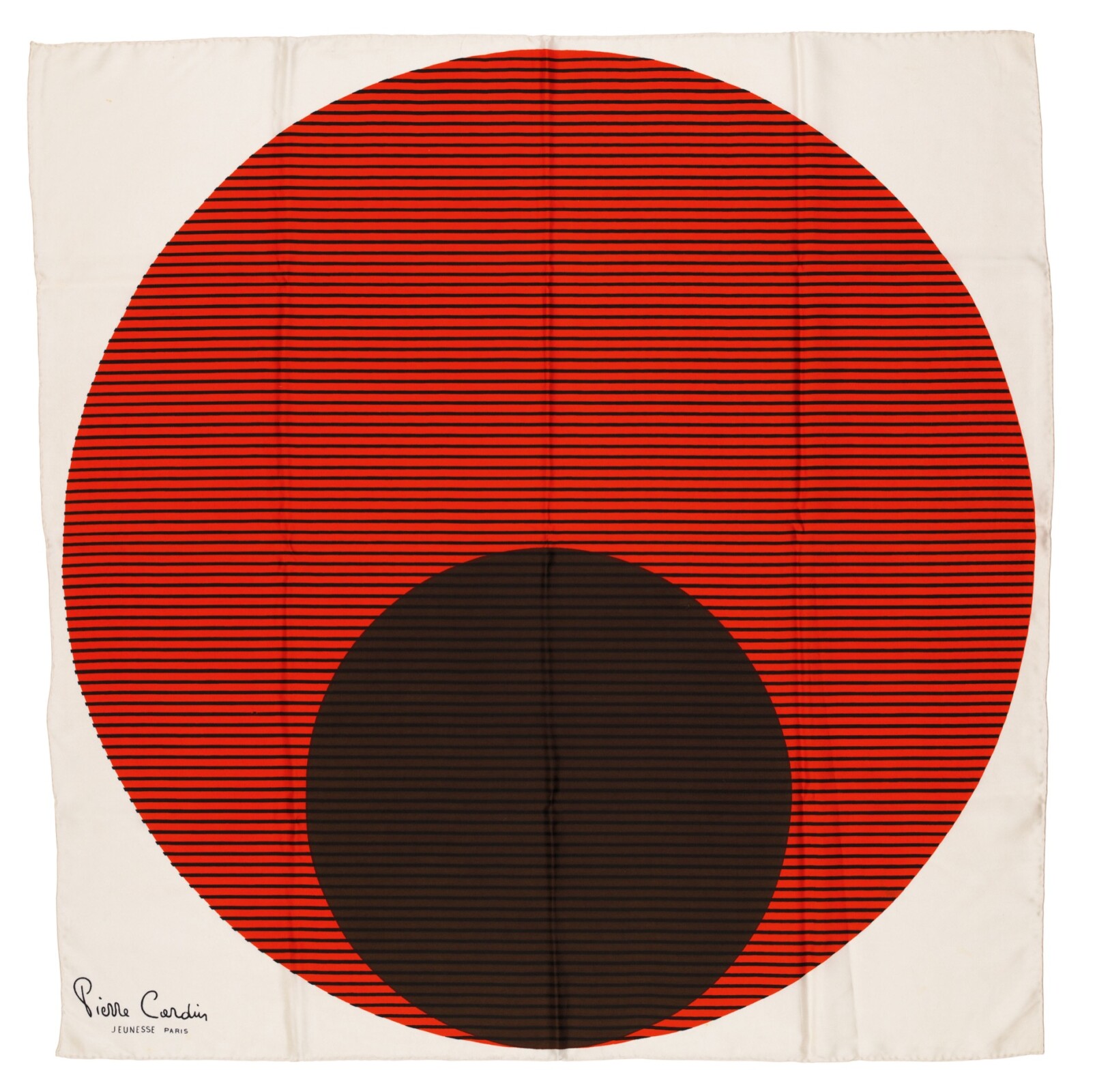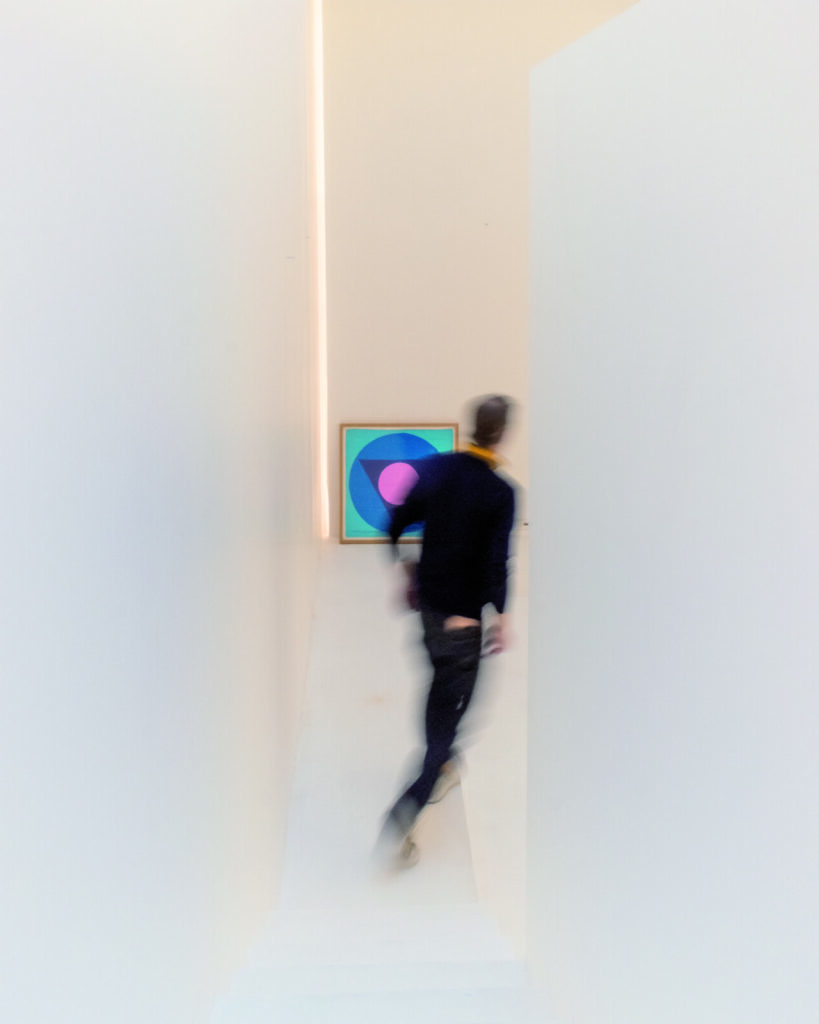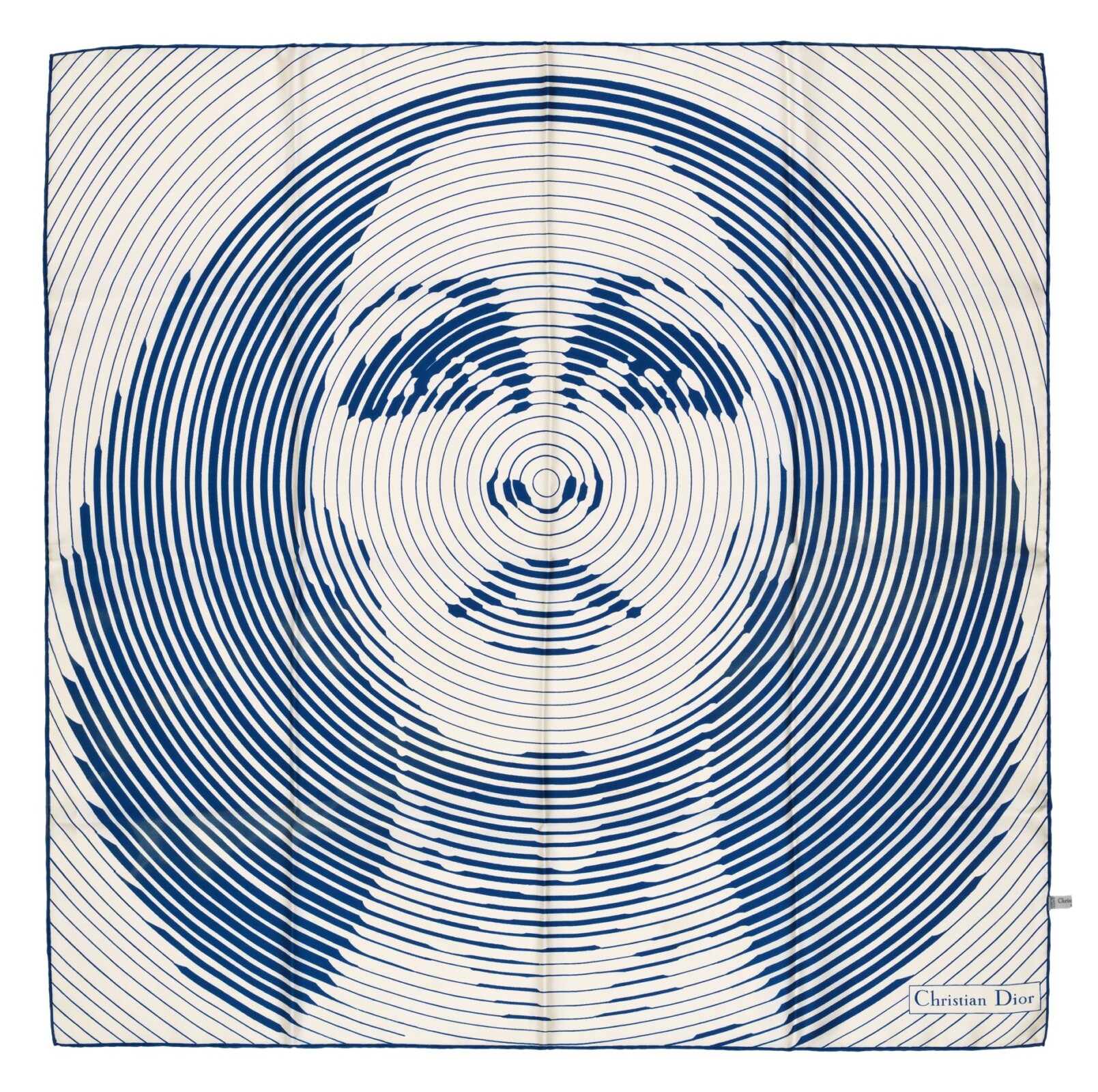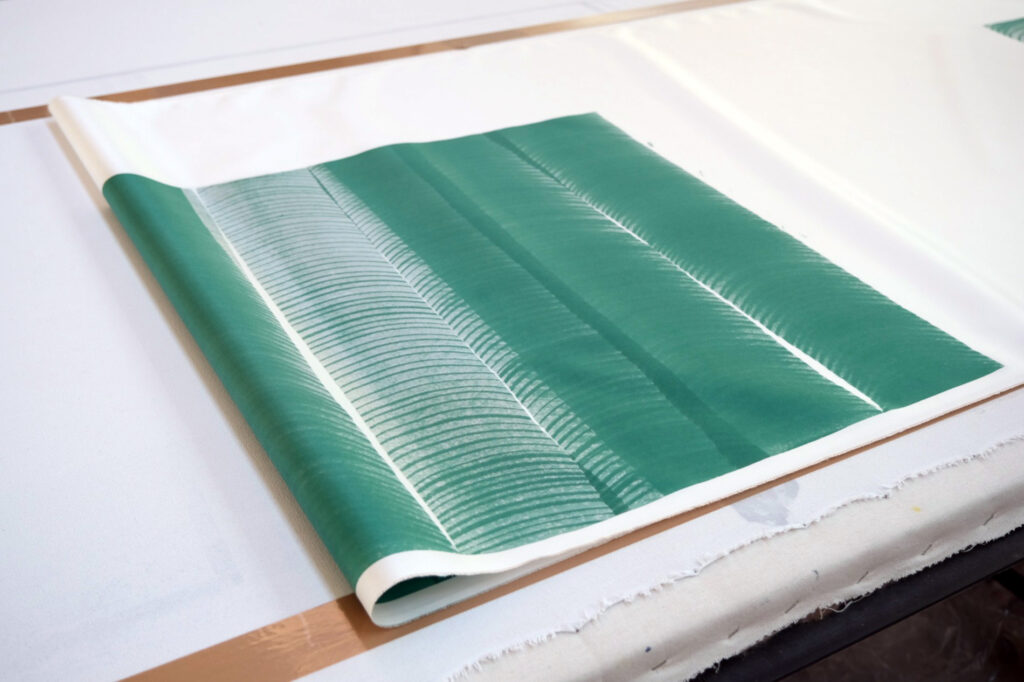_Vous êtes “Responsable de l’accompagnement des pratiques et des publics”, qu’est-ce que ça veut dire précisément ?
C’est très large ! Il y a toute la partie orientée vers le “public” dont s’occupe ma collaboratrice Anaïs Gittinger, qui est chargée de l’action culturelle. Ensemble, on travaille à la médiation et au développement du public, de la petite enfance jusqu’à l’Université, et on intervient aussi auprès de certains publics qui ne peuvent pas venir jusqu’à nous : en EHPAD, en maison d’arrêt, ou dans des instituts médicaux spécialisés. On leur propose des concerts, des ateliers d’écriture ou de composition avec les artistes du cru. Ce qui m’amène à ma seconde casquette : celle de l’accompagnement des pratiques.
Sous ma responsabilité, il y a aussi toute l’activité liée à nos studios de répétition, ouverts tous les jours de la semaine, dans lesquels on peut venir jouer de la musique pour une somme assez modique. 300 projets musicaux s’y croisent chaque année, ce qui représente plus d’un millier d’adhérents de tous profils, tous âges (du lycéen au retraité) et de tous niveaux (de l’amateur qui n’ambitionne pas de jouer en public, jusqu’à Vladimir Cauchemar.)
_Dans ces studios, on vient donc pratiquer, qui que l’on soit. Mais on peut aussi solliciter un accompagnement plus étroit, c’est cela ?
Absolument. On propose 3 dispositifs graduels, en fonction de l’état d’avancée des projets. Le dispositif “répétition” offre par exemple un soutien logistique aux artistes, avec un accès facilité aux studios ainsi qu’à un local de stockage. L’ambition et l’aboutissement du projet nous importent peu ici : c’est l’envie de pratiquer qui prime.
Les dispositifs “Carto Cru” et “Grand Carto Cru” demandent en revanche une véritable implication des artistes pour structurer et développer leur projet : ces deux accompagnements proposent des soutiens spécifiques pour émerger et/ou se professionnaliser davantage.
_Comment choisissez-vous les artistes que vous accompagnez chaque année ?
Grâce à des appels à candidatures, qu’on lance pour ces trois dispositifs.
Les lauréats sont sélectionnés par un jury composé d’une dizaine de personnes officiant dans les métiers de la musique (programmateur·ices, attaché·es de presse, directeur·ices de labels, tourneur·euses). Il y a chaque année 60 à 80 candidatures auxquelles nous faisons systématiquement un retour argumenté.
_Pour les chanceux qui sont lauréats, comment organisez-vous ensuite ce suivi au long cours ?
On se rencontre d’abord pour cerner tous les contours du projet artistique, ses objectifs et son niveau de développement. Puis, on établit ensemble un diagnostic et un programme d’actions séquencé sur l’année. La plupart du temps, les artistes qu’on accompagne ont déjà mené une réflexion sur leur projet et leurs ambitions. Nos dispositifs servent à apporter un soutien spécifique : qu’il s’agisse de travailler la communication en ligne, la méthodologie de démarchage pour trouver des dates, ou encore la création d’une scénographie pour le live.
Bien souvent, nous sommes face à des artistes dont on est le seul entourage professionnel: l’objectif est donc de travailler tous les aspects du projet pour qu’ils s’autonomisent le plus possible.
_Quels sont les jeunes artistes dont vous avez aimé croiser la route ?
Comme ça, à brûle-pourpoint, je pense à Fishback, par exemple, qu’on a accompagnée ici à ses tout débuts. Elle avait d’ailleurs participé à des actions culturelles en EHPAD, un public qui la touchait particulièrement.
Il y a aussi la rappeuse Leys, qu’on a suivie pendant deux années, avant qu’elle ne gagne le prix du jury des Inouïs en 2020, et se fasse connaître via l’émission Nouvelle École, sur Netflix. Je pense aussi au projet indépendant de l’artiste Ian Caulfield, au rappeur San-Nom qui a connu une belle visibilité et à Inward, un groupe de métal très talentueux qu’on accompagne en ce moment.
_Quels sont vos enjeux pour les années à venir ?
La question de l’égalité femmes-hommes reste un de nos axes de développement majeurs: trop peu de jeunes filles se lancent dans des projets de musiques amplifiées. C’est en train d’évoluer, mais il faut y travailler encore, et encore.
Tout comme il nous faut développer un certain public jeune, qui n’a pas pu se créer des habitudes de sorties culturelles, à cause du Covid. Notre enjeu est de leur faire découvrir le concert comme pratique à part entière, complémentaire de l’écoute sur les plateformes de musique. À la fin de l’année dernière, nous avons par exemple lancé des soirées “open mic” : en amorce de certains concerts de rap, on laisse la possibilité à des artistes en devenir de prendre le micro, une minute ou deux. Ça leur permet d’appréhender la performance en public et de désacraliser la scène. Ces soirées rencontrent un vrai succès et commencent à essaimer à Reims, ce qui me réjouit !
*Par le terme « Musiques Amplifiées », on désigne toutes les expressions musicales utilisant l’amplification électrique.