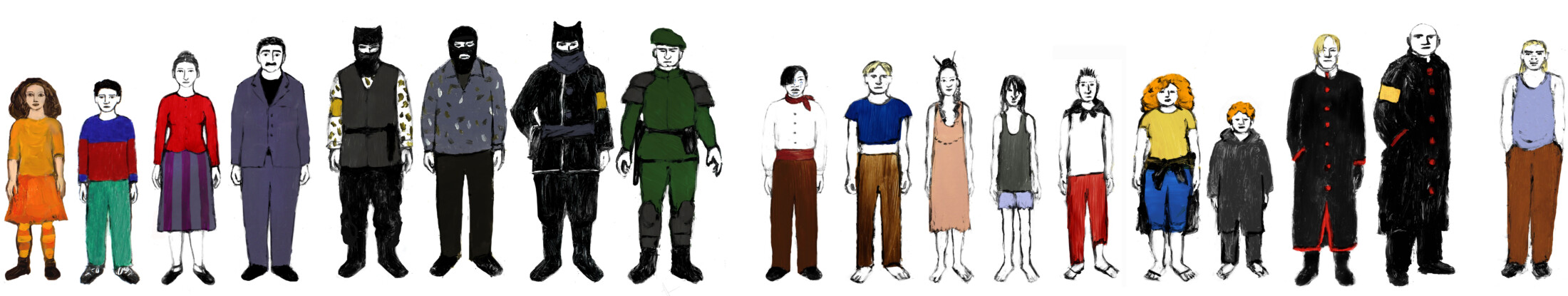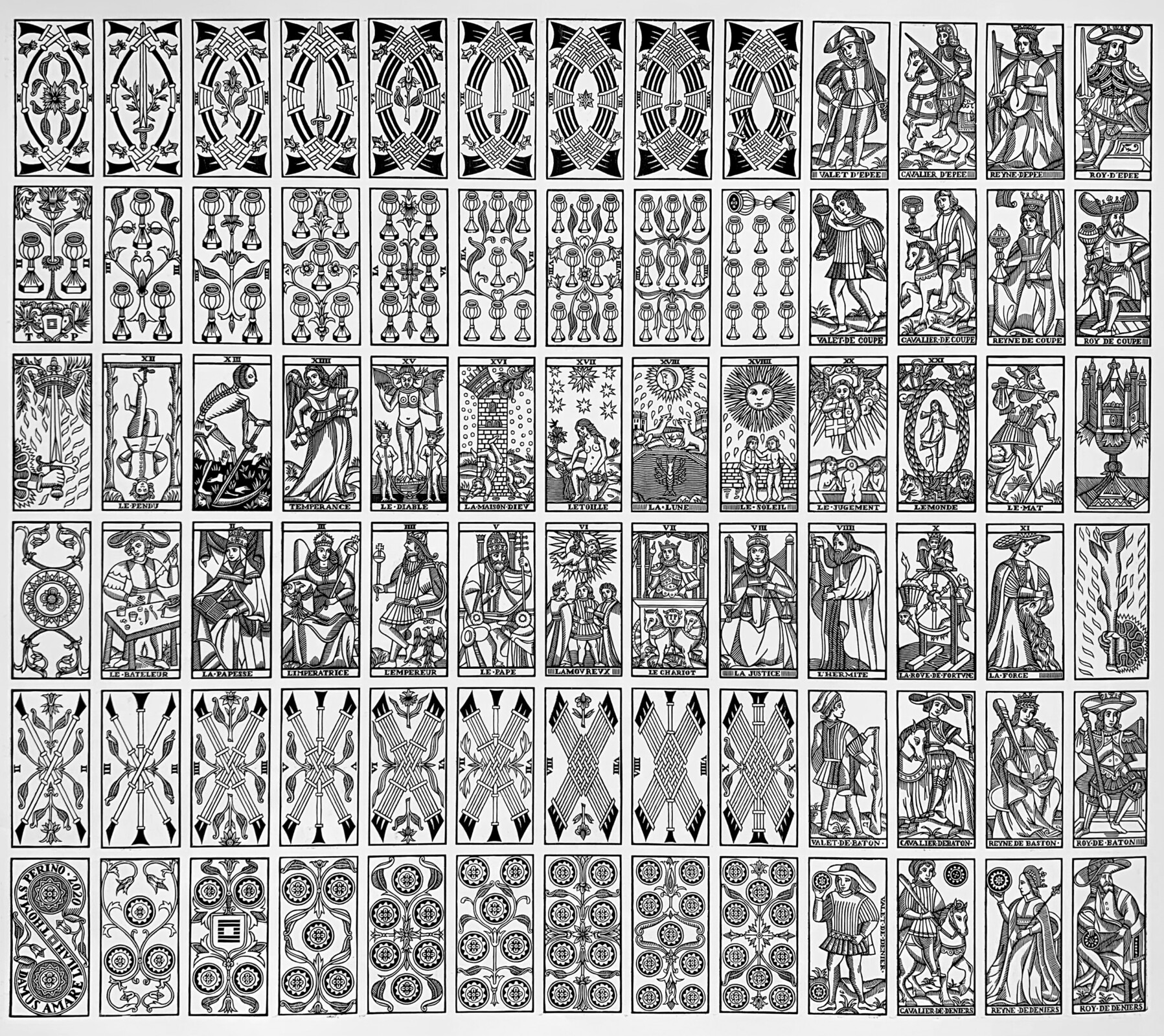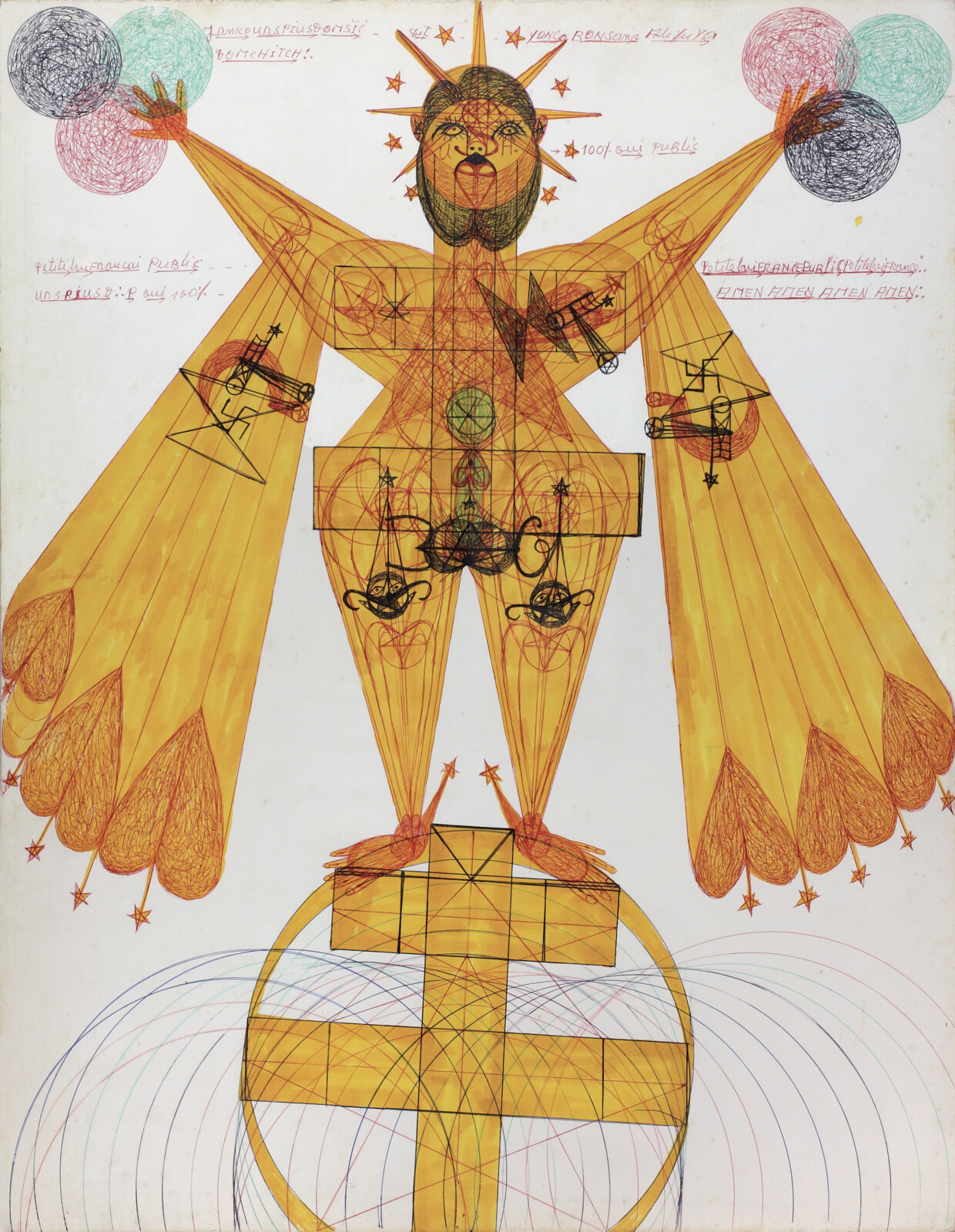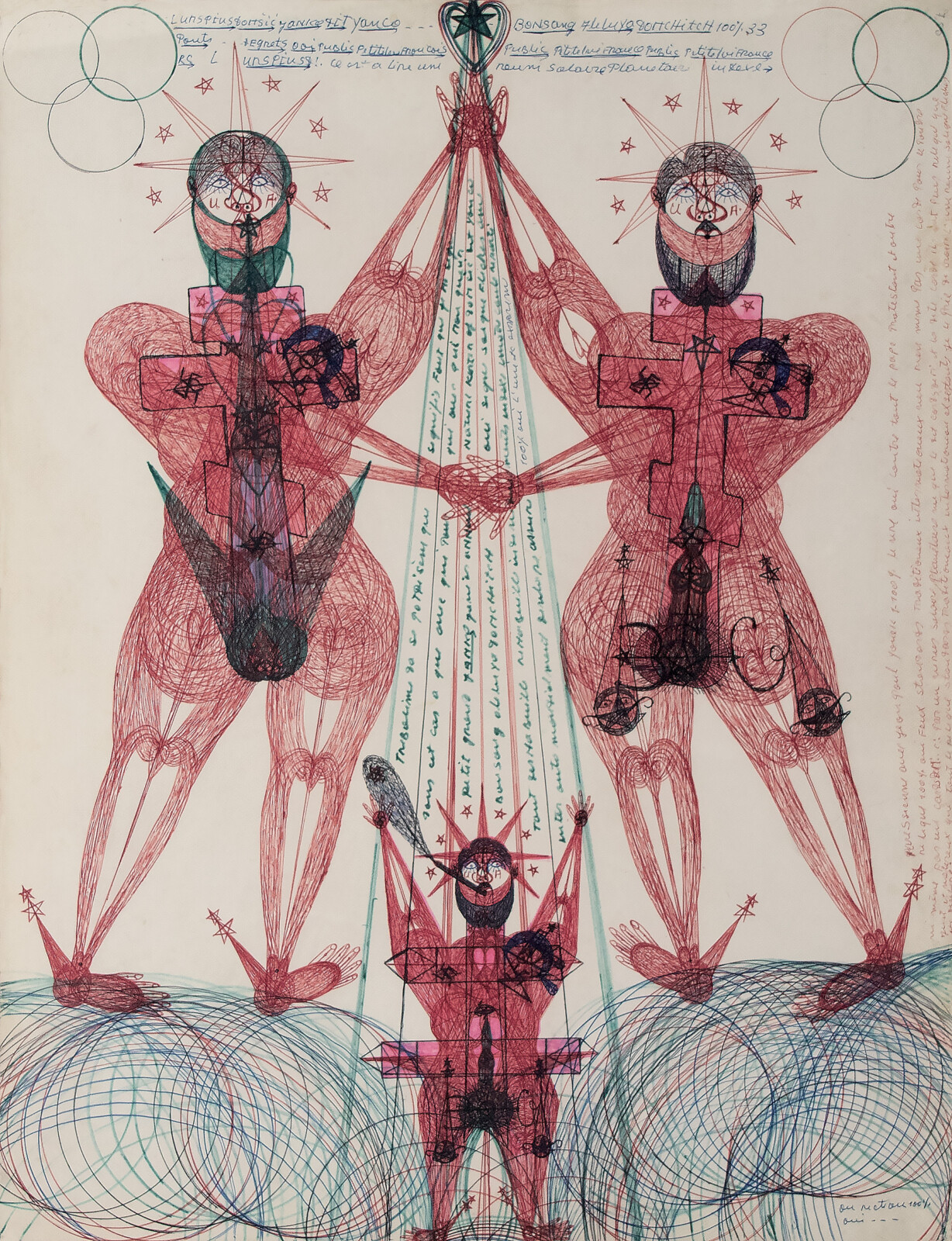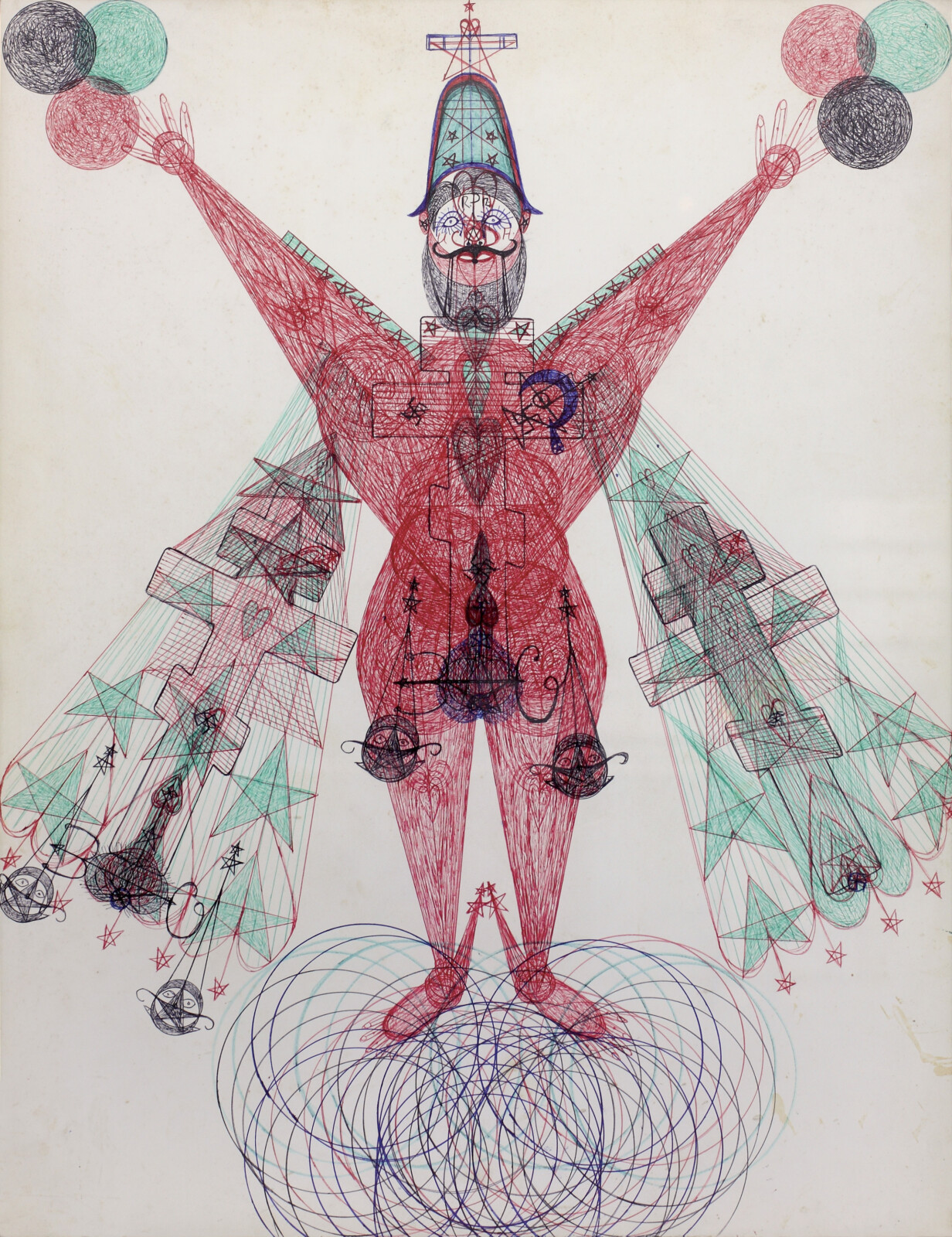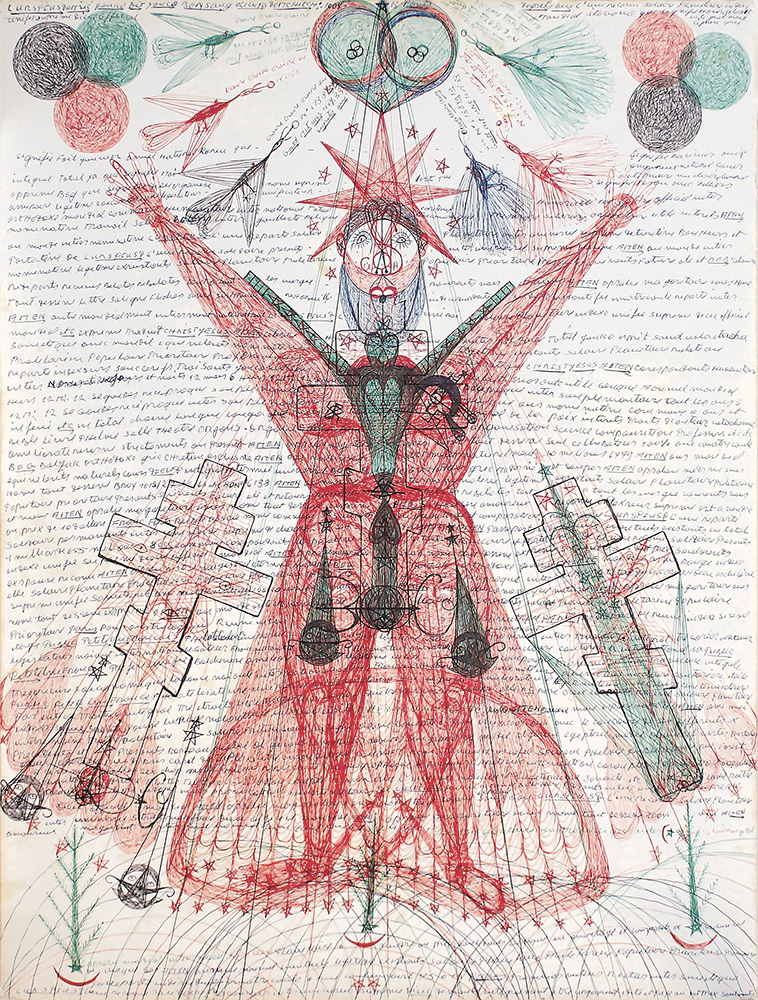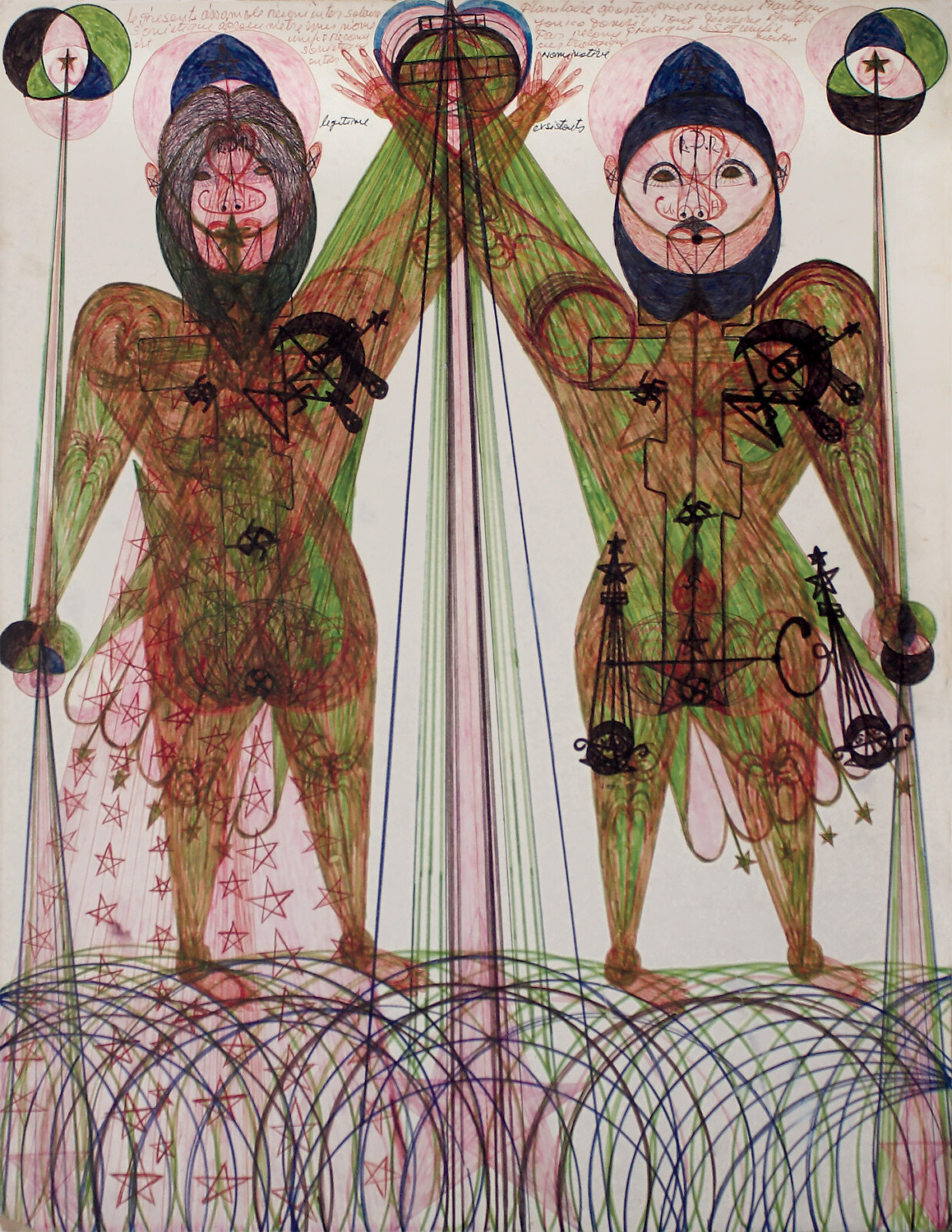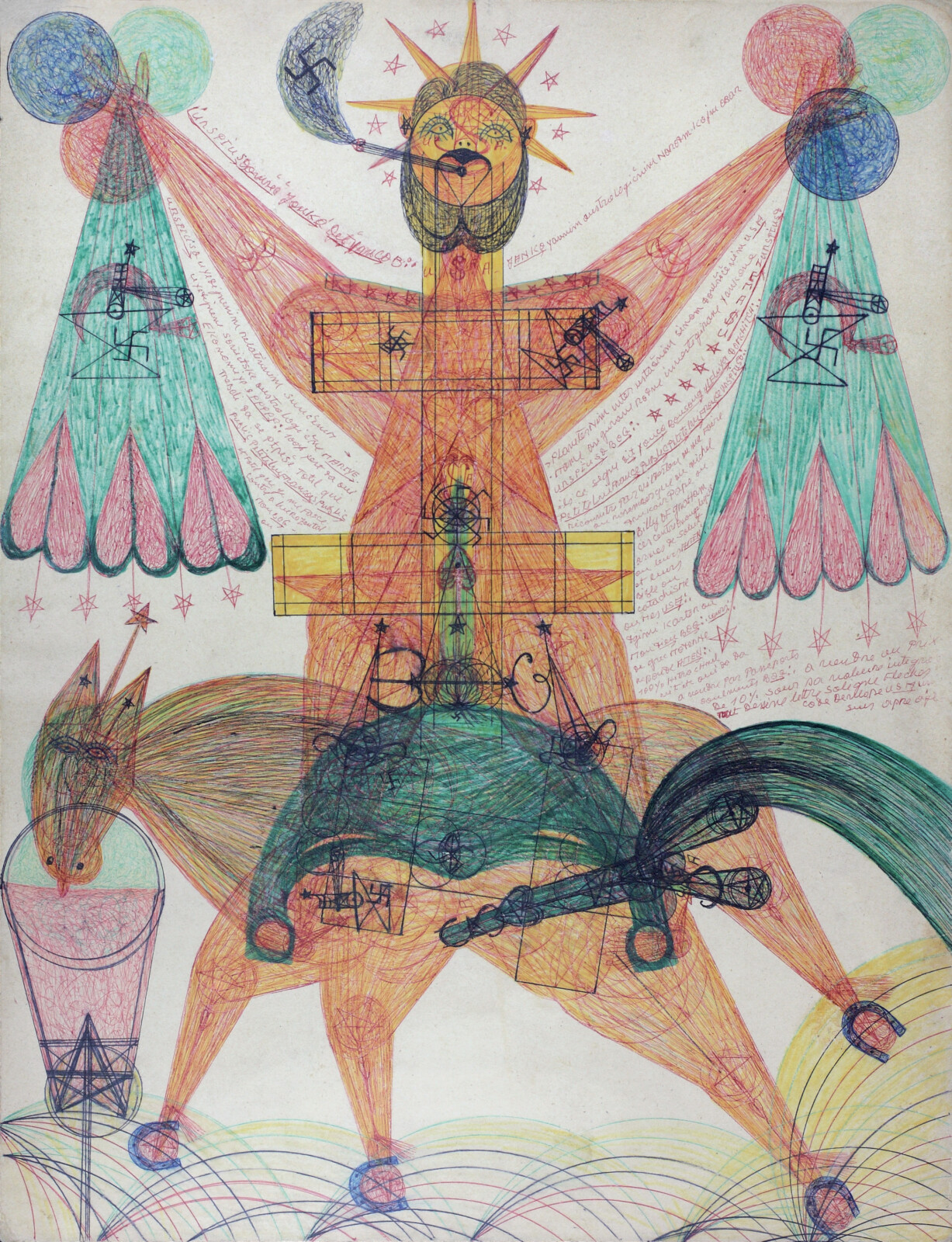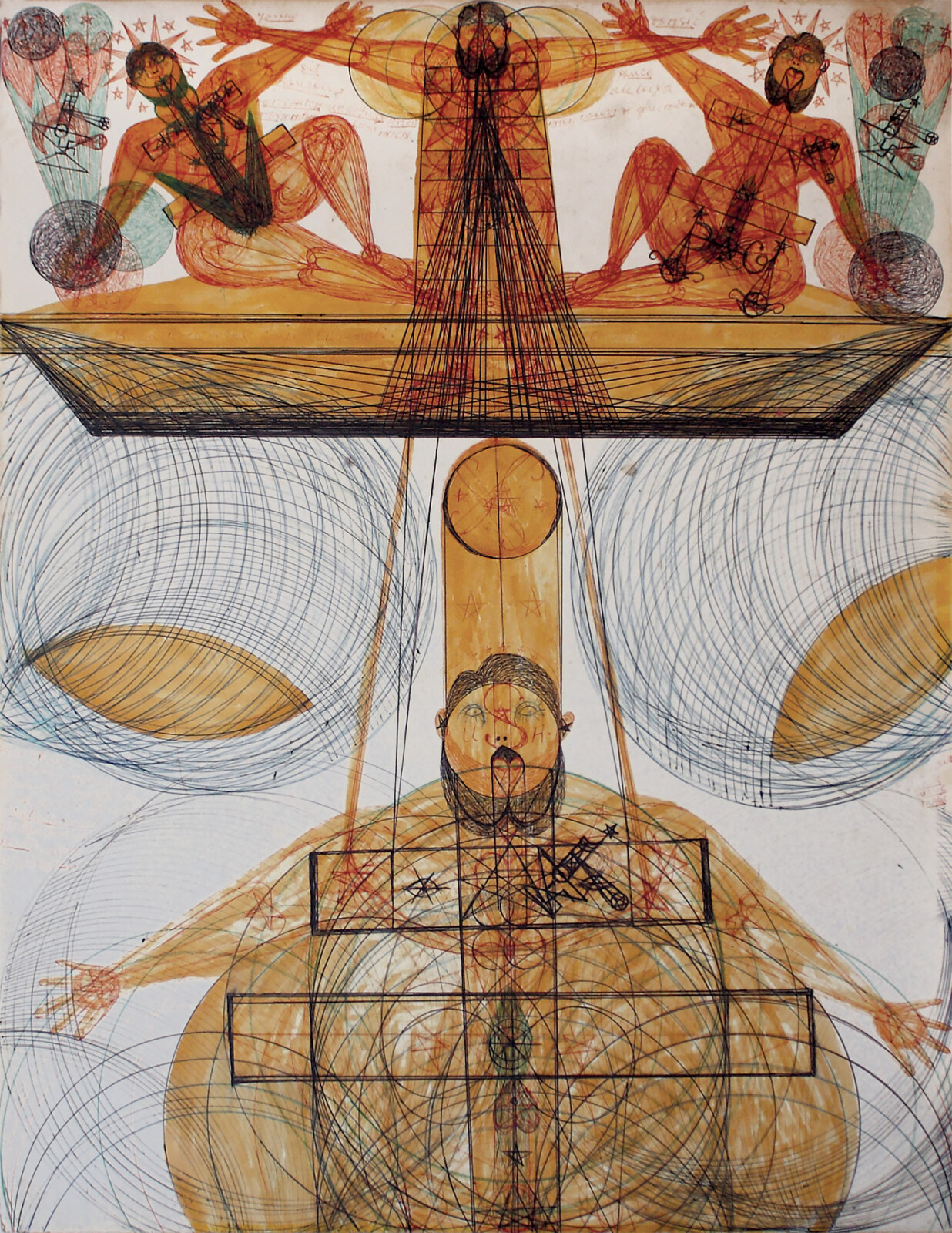C’est le portrait d’un volcan déguisé en colline. Sous des dehors de notable policé, une force vive vous fait face, tranquillement. Pas un de ces artistes à la sensibilité bruyante, mais plutôt un de ceux qui savent créer des silences puissants et une œuvre qui « embarque ». Un truc qui vient des tripes, sourd et âpre. Ses sculptures ne sont pas de celles qu’on dispose ça ou là. Elles sont ici. Taiseuses, elles emplissent un espace plus grand qu’elles dans lequel on choisit d’entrer comme on choisit d’entamer une discussion. Ce sera un dialogue des corps, des leurs – puisqu’elles ont presque forme humaine – et du nôtre, plutôt que celui des voix, car il n’y a rien à entendre et tout à ressentir.
Une enfance un peu à côté
Au départ, il y a un petit garçon qui semble s’être trompé de famille. On est en 1955, et, à Val-de- Vesle dans la Champagne pouilleuse, l’activité agricole occupe la plupart des foyers. Les fermes se transmettent de pères en fils, déroulant ainsi le fil des vies de générations en générations. Le petit garçon comprend assez tôt qu’il va avoir du mal à s’inscrire dans cette normalité, et surtout qu’il n’en a pas le désir : il ne se sent pas particulièrement concerné par les activités de loisir de ses camarades écoliers, il est le seul à lire dans sa famille, il ne rêve pas particulièrement de reprendre l’exploitation agricole, et se sent au contraire aussi à l’aise dans cet univers que dans une camisole de force. Il rêve d’un ailleurs ou d’un autre chose qui restera flou jusqu’à ce jour de 1970 où sa cousine l’emmène visiter le musée d’Art moderne de Paris. Le passage, et l’arrêt, devant un Soulages, déverrouille en une fois toutes ses perspectives. Il perçoit que l’ouverture sur le monde à laquelle il aspire se trouve par ici et que la vie vaudra largement d’être vécue, si elle est passée à générer des émotions comme le fait le maître de Sète.
Cette idée ne le quittera plus et le maintiendra en tension, jusqu’à son entrée aux Beaux-Arts de Reims, au nez et à la barbe de ses parents, puis aux Beaux-Arts de Paris. Classé parmi les premiers aux concours d’entrée, il quittera les cycles d’études quasiment achevés, mais sans diplôme, dans les deux cas. Que faire d’un diplôme, puisqu’il est sans objet de certifier une âme d’artiste ? Et puis, c’est la formation qui compte, le contact avec des maîtres, avec ceux qui peuvent aider à briser la paroi de verre entre l’intérieur de soi et le reste du monde. Et justement, il est un peu déçu. Il a plutôt senti du conformisme. Le souci de reproduire des schémas plutôt que de les dessiner. C’est la fuite, ou plutôt l’abandon. Il n’aura pas trouvé le maître qui aurait pu l’aider à devenir lui-même. Car voilà bien son souci, sa quête : trouver son propre chemin, avec une rigueur intellectuelle au scalpel. Il se cherche. Une galerie très sérieuse propose déjà ses œuvres à la vente avant qu’il ne quitte les Beaux-Arts. Il pratique à l’époque une peinture figurative teintée d’une approche conceptuelle : nature morte blanche sur fond blanc, un peu à la façon d’un Morandi. Ça fonctionne, et ça aurait pu fonctionner très longtemps, d’un point de vue formel, mais il sent qu’il aura vite fait le tour de ce travail, qui ne vient pas du cœur. Il sent qu’il lui faut retourner à la source, puiser dans quelque chose de tangible : ses racines, ce village, brutalisé par l’histoire – en 18 son grand-père à rebouché lui-même à la pelle les tranchées qui éventraient ses champs et dont il a pourtant cherché si ardemment à s’échapper. Il y a aussi cette église romane, qui le fascine depuis toujours. Et la lumière. Un lien invisible unit ces sentiments, un fil à tirer dont il pense que son œuvre peut être le catalyseur. Bien sûr, des raisons économiques guident aussi son retour, la vie à Val-de-Vesle s’avérant plus abordable que la vie parisienne…
En quête de soi
Il installe dans un coin de grange une chambre et un petit atelier. Et il travaille. Une vie de recherche opiniâtre augmentée de petits boulots alimentaires : cuisinier (il en garde de très bons réflexes au profit des visiteurs de passage), ouvrier agricole, peintre en enseigne… C’est un temps de recherche intranquille. On devine la sourde angoisse en toile de fond de celui qui sait clairement où est son destin, tout en sachant clairement qu’il n’en a pas trouvé la voie.
Il décide d’arrêter de dessiner et travaille sur le paysage, celui qui est là et celui qu’on ne voit pas, qu’il veut faire remonter en expérimentant des matériaux plus bruts comme la rouille et la cendre. Son travail prend une orientation « post-duchampienne », néologisme jargono-artistique se référant à la démarche de l’artiste du début du 20ème siècle Marcel Duchamp. Il se fait prêter par l’armée toute proche un immense hangar dont il fait son nouvel atelier et commence à exister un peu plus dans le paysage artistique en participant à une exposition qui fait le tour de la France sur les représentants de la nouvelle peinture française. Il est aussi identifié par l’institution, la DRAC notamment, et trouve sa place en tant qu’artiste reconnu.
On est en 1990, il vit maintenant à peu près de son art, mais il sait qu’il n’a pas encore trouvé sa vraie voie. Deux évènements vont favoriser sa découverte.
Les déclics
En 1992, il participe à la manifestation artistique « Arte Amazonas 92 » qui réunit 30 artistes internationaux. Il arrive avec un travail très conceptuel et assez politique (fondé sur l’utilisation d’un papier peint qui dénonce la vacuité de l’emploi de l’image de l’Amazonie) et en repart, bouleversé, par ses rencontres avec les populations locales et les autres artistes, et convaincu que, plus que jamais, il devait se concentrer sur quelque chose qui allait directement à l’essentiel. Il perçoit qu’il faut se détourner d’une veine qu’il juge désormais trop conceptuelle, qui, en revendiquant de formaliser du sens, reste au contraire beaucoup trop en surface. Après ce voyage, il se sentira beaucoup plus proche de la démarche d’artistes pariétaux, que de celle d’un Marcel Duchamp, pour forcer un peu le trait… Une posture tout à fait à rebours des tendances artistiques de l’époque.
En 92 se produit un autre événement qui va le marquer profondément. Son déroulé est complexe, et suit plusieurs étapes, mais on peut sans doute le résumer comme ceci : le musée de la Reddition de la guerre 39-45 de Reims lui avait commandé une œuvre en mémoire de cet événement qui n’a pas eu l’heur de plaire à la veuve du général Jodl, représentant de l’Allemagne pour cette signature du 7 mai 1945. Il s’agissait d’une œuvre conceptuelle réunissant symboliquement les armes des belligérants comme matériau de fabrication d’une table en référence à celle de la signature. Elle s’en est ouverte à différentes instances et médias, et, pour finir, au Président de la République française de l’époque, François
Mitterrand, qui a simplement fait savoir – ordonné ? – qu’il ne souhaitait pas qu’on installe l’œuvre de Christian Lapie. Ce dernier engage alors un procès qu’il gagnera en 1995, mais sortira assez écœuré et effrayé qu’au tournant du 21ème siècle un geste de censure manifeste soit aussi simplement possible.
Cette péripétie achève d’aiguiser son besoin d’essentiel et c’est cette même année qu’il définit la forme des œuvres qu’on connaît aujourd’hui. L’histoire est touchante de simplicité évidente.
Avec l’aide du feu
En entretenant un feu dans sa cheminée un jour d’hiver, il avise une bûche consumée qui semble dessiner une silhouette, comme un enfant reconnaitrait des animaux imaginaires dans le mouvement des nuages. Il l’extrait du foyer, et l’arrange un peu avec un tisonnier : la toute première de ses figures apparaît devant lui. Il reproduit avec les moyens du bord, et sans aucune expertise, d’autres figures sur le même schéma dans les heures et les jours qui suivent, et très vite les associe en groupes. Ça fonctionne. Quelques jours plus tard, un galeriste bâlois de passage tombe dessus et décide de l’emporter dans l’instant. Il la vendra quelques jours plus tard.
On est en 95, Christian Lapie a 40 ans, et pour la première fois, il se sent, avec ce travail, parfaitement en phase avec lui-même. Il produit quelque chose qui coche toutes les cases de ce qui lui importe : c’est lisible par tous, ça représente l’humain, c’est matériellement humble et réalisable avec peu et partout, c’est en lien avec quelque chose qui s’est passé et ça s’en fait le média, ça parle sans mots au plexus plutôt qu’à la tête, c’est puissant et plastiquement beau. On sourit, en songeant que lui qui brulait depuis tant d’années de trouver le moyen de l’œuvre la plus juste, lui qui se consume depuis toujours pour trouver l’exact médium qui lui permettra de libérer l’incandescence des émotions qui l’habitent, trouve finalement sa voie dans un feu dont il parvient à fixer l’énergie dans un être de bois noirci.
Depuis cette date, Christian est devenu un explorateur de la brèche qu’il a ouverte. Il chemine sur la piste apparue dans sa cheminée et fait de ses œuvres une voix, un outil de transmission. Elles sont son instrument. Grâce à elles nous sentons la présence des soldats tombés à la caverne du Dragon, l’esprit indicible d’un lieu, ou la présence floue d’âmes oubliées. Elles agissent comme des passeurs entre maintenant et ailleurs, entre ici et avant. Le mot « transcendance » est dans l’air en les observant. Il reviendra souvent dans la bouche de Christian.
Les commanditaires ne s’y trompent pas, et ils s’adressent souvent à Christian, non pour agrémenter ou se faire plaisir, mais d’abord pour transmettre quelque chose. Ils ne le savent pas toujours, mais le sentent, à chaque fois. Et la notion de groupe est souvent présente : l’esprit d’une famille, un bataillon qui a donné sa vie, une forêt décimée réincarnée…
À partir de 95, les projets s’enchaînent et la reconnaissance devient internationale. Avec des moments forts : l’installation dans le cadre d’Echigo-Tsumari au Japon en 2000, celle de Djaoulerou en 2001 au Cameroun (détruite depuis par des islamistes), la commande du Château de l’Abrègement en 2002 avec les chênes abattus par la tempête de 99, l’installation de Jaipur au Rajasthan (la première en pierre), celle de la Caverne des Dragons sur le chemin des Dames en 2007, la collection permanente du Domaine de Chaumont-sur-Loire en 2015… Et une multitude de projets publics, de commandes privées, d’œuvres réalisées pour lui-même, de gravures, de goudrons, de bronzes, et de nouveau, de dessins… Une galaxie de ces figures noires, toutes uniques, toutes dotées de la même force irradiante, qu’en bon entrepreneur il a pris soin de ne jamais changer pour mieux en inscrire l’image, comme un logo « Lapie », dans la rétine des observateurs.
Cette répétition n’est pas un problème, ni même, une question pour lui. Elle fait partie de l’œuvre. C’est une forme d’ascèse qui donne du sens à l’ensemble. Elle répond au besoin de ne pas s’éparpiller. Et puis, les œuvres sont toutes différentes en réalité. Différentes comme les êtres humains, que la nature, a façonnés identiques et dissemblables.
Les arbres et les œuvres
Il ne sait d’ailleurs pas exactement ce qu’il va trouver quand il va chercher, l’hiver, des arbres dans la forêt ardennaise. Il parcourt la forêt jusqu’à trouver un arbre lui offrant des perspectives satisfaisantes et l’achète sur pied en pariant sur ce qu’il aura à lui offrir. L’arbre est ensuite transporté jusqu’à son atelier en plein air de Val-de-Vesle. Avec une équipe de trois ou quatre personnes, il va le fendre, à la main. Au moment de « l’ouverture », il y a un pur geste artistique, un mouvement intuitif de ce qu’il peut en faire. Et aussi un moment d’émotion, c’est un être vivant de 300 ou 400 ans qui va entrer dans une nouvelle vie. Très vite, il dégage la figure, esquisse la tête, dessine les épaules. L’arbre devient rapidement une œuvre qui prendra complètement son autonomie quand elle sera redressée et fichée sur une épaisse plaque de métal dotée de tire-fonds pour maintenir la pièce debout face aux aléas du climat.
L’œuvre naissante, la plupart du temps en chêne pour des questions de résistance mécanique et chimique, subit ensuite un passage sous vide à l’huile de lin qui assurera sa résistance au temps. Elle est enfin teintée en noir pour quitter son statut d’arbre et s’inscrire définitivement dans le champ de l’art.
En 2019, par une de ces boucles que peut parfois réserver la vie, il est invité à concevoir plusieurs installations monumentales à Rodez en l’honneur de Pierre Soulages, pour la célébration de son centenaire. On lui donne l’occasion de rendre hommage à celui dont le travail a été l’éclat de silex allumant son feu intérieur 50 ans plus tôt. Les planètes semblent s’être alignées, et faire un clin d’œil à l’opiniâtreté de sa rigueur intellectuelle et à « l’enfant qui voulait être artiste ». Comme un retournement espiègle de situation, c’est cette fois Soulages qui va admirer l’œuvre de Christian. Il aura tout le loisir d’observer dans les 100 prochaines années comme il a su, avec sa sculpture, trouver la forme exacte de sa sensibilité, et l’amplifier mille fois en en faisant la voix des âmes et des lieux.